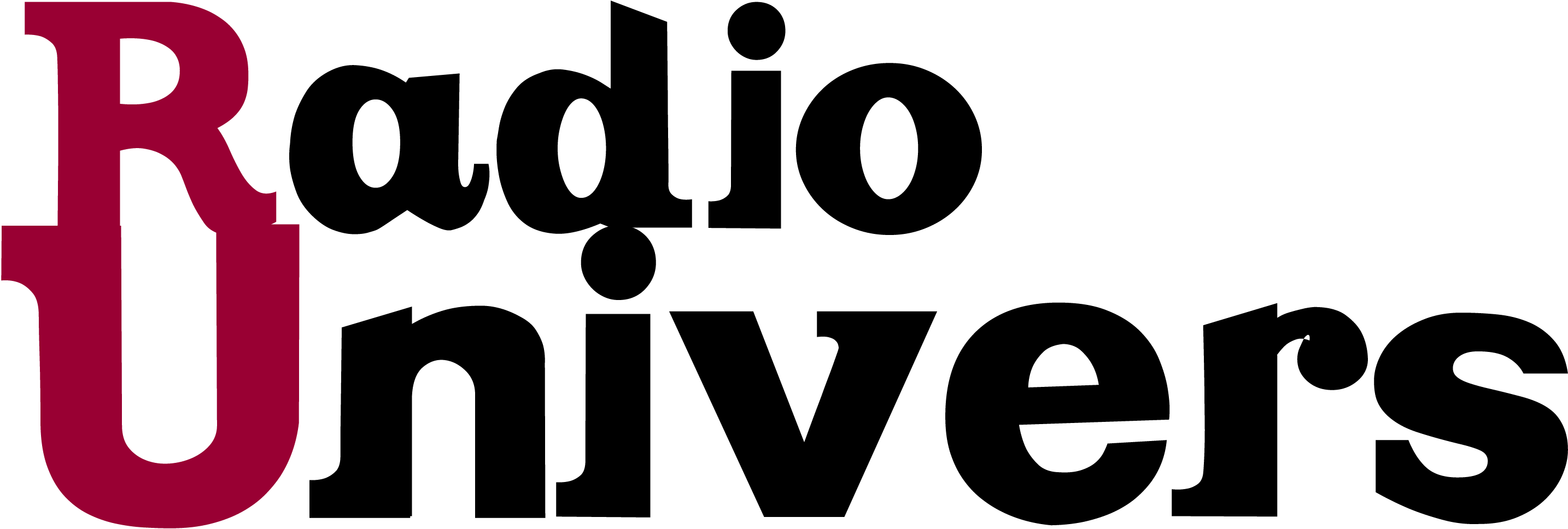Retour à… Kristin Ross. N°1180
Écrit par admin sur 25 décembre 2024
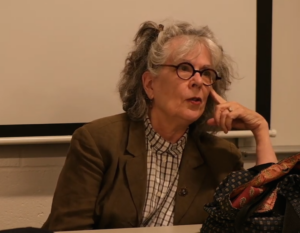 Retrouvons-la à l’occasion d’un texte titré Composition, publié dans le journal e-flux qui est une publication mensuelle sur l’art basée à New-York, où l’on y présente des essais et des contributions d’artistes et de penseurs contemporains.
Retrouvons-la à l’occasion d’un texte titré Composition, publié dans le journal e-flux qui est une publication mensuelle sur l’art basée à New-York, où l’on y présente des essais et des contributions d’artistes et de penseurs contemporains.A la fois mobilisation et territoire partagé en commun, la forme Commune est un mouvement politique qui est aussi l’élaboration collective d’un mode de vie souhaité – le moyen devenant la fin. En tant que telle, elle est peut-être le seul moyen rationnel pour les gens de reconnaître et d’organiser leurs propres forces en tant que forces sociales : selon les mots de Marx, « une reprise par le peuple pour le peuple de sa propre vie sociale ». En tant que forme, elle est à la fois spécifique, c’est-à-dire reconnaissable, et infiniment transmutable ; elle se transforme facilement pour prospérer dans des temps et des lieux différents. Ce que Kropotkine disait de la société anarchiste pourrait bien être dit de la forme Commune : « Elle ne se cristallise pas en une certaine forme immuable, mais elle modifiera continuellement son aspect. » Et ce à quoi cet aspect modifié pourrait ressembler ne peut être déterminé que dans l’acte de sa réalisation, puisque la commune doit être formée ou composée – elle doit prendre forme, elle doit être construite. Toujours située dans un lieu particulier, un territoire, un quartier, une forêt, un milieu spécifique, la forme commune consiste à « produire » de l’espace, comme disait Lefebvre : construire des espaces et des lieux au sens le plus littéral et le plus pragmatique du terme, et veiller à leur fonctionnement quotidien. « “Changer la vie !” “Transformer la société !” Ces préceptes ne veulent rien dire s’il n’y a pas production d’un espace approprié. » Cette attention pragmatique et quotidienne à la gestion collective des préoccupations communes est ce que le mot « commune » évoque le plus systématiquement dans ses premiers usages historiques. L’historien médiéval Charles Petit-Dutaillis écrit : « En bref, le mot commune évoque avant tout l’idée non pas d’un gouvernement libre mais d’un groupe qui s’est constitué pour gérer des intérêts collectifs. » Dans son étude des usages du mot au Moyen Âge, Petit-Dutaillis a découvert que « plus ou moins directement, mais presque constamment, le mot désigne les efforts d’une collectivité pour mieux protéger ses intérêts moraux et matériels. » L’idée d’une gestion ou d’une administration collective de la vie quotidienne est renforcée, selon lui, par l’étymologie du mot. Contestant les étymologies récentes qui font remonter le sens du mot à une connotation juridique (la commune en tant qu’ensemble de lois régissant une communauté), Petit-Dutaillis montre que le mot dérive du latin communio, signifiant simplement « association ». Dans l’usage courant au XIIe siècle, affirme-t-il, le mot « commune » signifiait une union de personnes partageant des intérêts communs, une association. La défense par Petit-Dutaillis d’un sens administratif du mot plutôt que gouvernemental trouve un écho puissant dans les écrits du communard parisien Jules Andrieu. En charge de l’administration communale de la ville de Paris pendant la Commune de 1871, Andrieu s’occupa de la gestion quotidienne du fonctionnement de la ville et de la survie matérielle de ses habitants. Pour Andrieu, l’aspect le plus « satanique » du plan de bataille du président de l’époque, Adolphe Thiers, était la cessation soudaine des services publics et les conséquences qu’une telle série d’arrêts brusques aurait sur la vie quotidienne de la ville. En un jour ou deux, le chaos régnerait : cadavres sans sépulture dans les cimetières, fontaines publiques taries, ordures ménagères dans les rues, égouts débordants. Pour Andrieu, le projet de la Commune était de distinguer à tout moment le niveau municipal du niveau national ; l’idée était d’administrer Paris et les besoins quotidiens de ses habitants et d’éviter tout ce qui semblait relever du gouvernement national : « L’idée à l’origine du mouvement du 18 mars… [était] que la Commune de Paris renonçait à gouverner la France. » Andrieu considérait que son rôle était de s’immerger dans les dimensions les plus élémentaires du fonctionnement de la ville – de la distribution de nourriture à l’assainissement, de l’éclairage et de l’accès à l’eau à la gestion des cimetières – et d’ignorer, pour l’essentiel, les feux d’artifice verbaux et peut-être les démonstrations de rhétorique qui se déroulaient chez certains de ses collègues de l’Hôtel de Ville. La Commune n’était pas quelque chose qui pouvait être proclamé ; il fallait la construire de toutes pièces. « La Commune », écrivit-il plus tard, « avait besoin d’administrateurs ; elle grouillait de gouverneurs. » Pour Andrieu, les « gouverneurs » étaient ceux qui promulguaient des décrets sans assumer la responsabilité de leur exécution, qui se posaient en vue de l’avenir au lieu de parler dans et au moment présent : « C’est démodé, c’est théâtral, c’est jacobin. » Les administrateurs, au contraire, sont ceux qui répondent chaque jour aux nécessités quotidiennes et qui se chargent d’y répondre du mieux qu’ils peuvent : « En temps de révolution, proclame Andrieu, je crois que tout ce qui n’est pas utile est nuisible. »
*

 À Valparaíso, au Chili, un exercice similaire de solidarité entre groupes divers a remporté une victoire notable. Fin 2017, la Cour suprême chilienne a annulé le permis de construire d’un immense centre commercial qui aurait occupé toute la zone portuaire historique, un front de mer opérationnel. Cette résolution a mis fin à une nouvelle bataille de dix ans entre les habitants et les promoteurs. Les centres commerciaux de style nord-américain au Chili, comme les aéroports en Espagne, ont proliféré dans tout le pays, sous le signe de la modernisation, de la création d’emplois et de la croissance économique. Mais ce projet en particulier éclipsait tous les autres en termes d’échelle : il devait inclure 162 boutiques de luxe, en plus de centres de congrès et même d’un parc à thème. Une fois de plus, une autre alliance improbable – composée principalement de dockers, d’artistes, d’urbanistes et d’étudiants – a vu clairement ce centre commercial pour ce qu’il était : un espace conçu non pas pour eux mais pour les touristes et les chefs d’entreprise de passage, et donc un pillage du bien commun. Ce fut une autre guerre prolongée, mais même si elle nécessita dix ans d’actions concertées, de manœuvres juridiques et d’improvisations, ils réussirent à défendre leur ville et son front de mer.
À Valparaíso, au Chili, un exercice similaire de solidarité entre groupes divers a remporté une victoire notable. Fin 2017, la Cour suprême chilienne a annulé le permis de construire d’un immense centre commercial qui aurait occupé toute la zone portuaire historique, un front de mer opérationnel. Cette résolution a mis fin à une nouvelle bataille de dix ans entre les habitants et les promoteurs. Les centres commerciaux de style nord-américain au Chili, comme les aéroports en Espagne, ont proliféré dans tout le pays, sous le signe de la modernisation, de la création d’emplois et de la croissance économique. Mais ce projet en particulier éclipsait tous les autres en termes d’échelle : il devait inclure 162 boutiques de luxe, en plus de centres de congrès et même d’un parc à thème. Une fois de plus, une autre alliance improbable – composée principalement de dockers, d’artistes, d’urbanistes et d’étudiants – a vu clairement ce centre commercial pour ce qu’il était : un espace conçu non pas pour eux mais pour les touristes et les chefs d’entreprise de passage, et donc un pillage du bien commun. Ce fut une autre guerre prolongée, mais même si elle nécessita dix ans d’actions concertées, de manœuvres juridiques et d’improvisations, ils réussirent à défendre leur ville et son front de mer. En avril 2021, un mouvement a commencé à défendre la forêt de Weelaunee à Atlanta, en Géorgie, contre son rasage et son remplacement par un complexe de formation policière de 90 millions de dollars. « Cop City », comme les opposants ont appelé le projet, devait paver plus de 381 acres de la plus grande forêt urbaine d’Amérique du Nord pour construire un terrain où la police pourrait s’entraîner avec des commandos israéliens, importés pour le travail, pour apprendre à gérer des scénarios de guerre urbaine. Après l’échec des tentatives habituelles de faire pression sur le conseil municipal pour qu’il ne donne pas son approbation finale à sa contribution de 30 millions de dollars au projet, les occupants se sont emparés des arbres, construisant et habitant des cabanes de fortune dans les arbres, leurs fournitures leur étant apportées par un éventail d’aides : des écoliers et leurs parents, des étudiants de l’université Emory et d’autres universités voisines, des membres de la classe ouvrière et de la communauté pauvre du quartier à majorité noire jouxtant la forêt, parmi ceux pour qui la perte de leur précieux espace vert à proximité serait certainement plus dévastatrice que pour les autres habitants d’Atlanta. L’occupation de la forêt, mi-festival, mi-camp de réfugiés, a duré jusqu’à une expulsion brutale en janvier 2023. Il est important de souligner, comme le fait plus généralement Lefebvre, le manque d’unité identitaire ou idéologique au cœur de telles coalitions. Les formes communautaires d’« habiter » ou de « partager l’usage » – notamment du territoire – sont directement politiques d’une manière qui nous permet de rompre avec les modalités idéologiques et identitaires. La ZAD n’était pas une petite chapelle de fidèles partageant les mêmes idées et chantant le même hymne. Le collectif de la ZAD Mauvaise Troupe a donné un nom au processus de maintien de la diversité tactique face à un ennemi commun : ils l’ont appelé « composition ». La composition est un autre nom pour le sujet collectif formé à partir des nombreuses sortes de personnes engagées dans la construction et la poursuite de l’occupation à travers toutes ses nombreuses métamorphoses. Il y a un lien évident avec la subjectivité politique relationnelle qui a caractérisé les mouvements antérieurs des années 1960 et 1970, comme dans la coalition tripartite évoquée plus haut qui a émergé à Nantes en 1968 lorsque des paysans ont rejoint des étudiants et des ouvriers en grève. Une subjectivité relationnelle d’un type similaire est certainement née de la rencontre entre les agriculteurs de la préfecture de Chiba au Japon (qui ont commencé par défendre leur mode de vie et ont appris en cours de route quel type de violence écrasante l’État leur réservait) et les étudiants et les ouvriers urbains (qui se sont déplacés pour rejoindre les agriculteurs et ont appris ce faisant pour la première fois comment et où la nourriture qu’ils mangeaient était produite). Le type de base sociale créée à la ZAD, cependant, ou lors de l’occupation de Stop Cop City à Atlanta, par exemple, était différent – essentiellement une alliance de travail, comme dans les mouvements des années 1960 et 1970 évoqués plus haut, mais qui implique également le partage au fil du temps d’un territoire physique, d’un espace de vie. Lorsque des gens d’origines et de croyances radicalement différentes se rassemblent de manière pragmatique au quotidien pour accomplir les tâches et élaborer les programmes en constante évolution d’une occupation territoriale, une sorte de communauté politique polémique se crée. La composition commence lorsque des gens d’origines différentes, avec des façons de penser différentes, des histoires et des relations différentes avec la terre, des compétences différentes et parfois une tolérance au risque très différente décident d’agir ensemble, sous prétexte d’égalité, pour défendre un territoire. Un nouveau sujet collectif – le résultat de déplacements et de désidentifications mutuels et de l’action d’égaux en tant qu’égaux – est produit, essentiellement, par la pratique, par un engagement créatif et partagé dans la construction, la défense et le maintien de la vie de l’occupation au jour le jour. Produit d’un investissement massif dans l’organisation de la vie en commun, la composition se débarrasse des types d’exclusions fondées sur des idées, des identités ou des idéologies si fréquemment rencontrées dans les milieux radicaux, de tout le sectarisme fatigué de l’histoire de la gauche. En tant que telle, c’est une manière de faire un monde, le tissage d’un nouveau type de solidarité – une solidarité où l’unité de l’expérience compte plus que la divergence des opinions, et qui amplifie également la conviction de Kropotkine selon laquelle la solidarité n’est pas une éthique ou un sentiment moral, mais plutôt une stratégie révolutionnaire, et peut-être la plus importante de toutes.
En avril 2021, un mouvement a commencé à défendre la forêt de Weelaunee à Atlanta, en Géorgie, contre son rasage et son remplacement par un complexe de formation policière de 90 millions de dollars. « Cop City », comme les opposants ont appelé le projet, devait paver plus de 381 acres de la plus grande forêt urbaine d’Amérique du Nord pour construire un terrain où la police pourrait s’entraîner avec des commandos israéliens, importés pour le travail, pour apprendre à gérer des scénarios de guerre urbaine. Après l’échec des tentatives habituelles de faire pression sur le conseil municipal pour qu’il ne donne pas son approbation finale à sa contribution de 30 millions de dollars au projet, les occupants se sont emparés des arbres, construisant et habitant des cabanes de fortune dans les arbres, leurs fournitures leur étant apportées par un éventail d’aides : des écoliers et leurs parents, des étudiants de l’université Emory et d’autres universités voisines, des membres de la classe ouvrière et de la communauté pauvre du quartier à majorité noire jouxtant la forêt, parmi ceux pour qui la perte de leur précieux espace vert à proximité serait certainement plus dévastatrice que pour les autres habitants d’Atlanta. L’occupation de la forêt, mi-festival, mi-camp de réfugiés, a duré jusqu’à une expulsion brutale en janvier 2023. Il est important de souligner, comme le fait plus généralement Lefebvre, le manque d’unité identitaire ou idéologique au cœur de telles coalitions. Les formes communautaires d’« habiter » ou de « partager l’usage » – notamment du territoire – sont directement politiques d’une manière qui nous permet de rompre avec les modalités idéologiques et identitaires. La ZAD n’était pas une petite chapelle de fidèles partageant les mêmes idées et chantant le même hymne. Le collectif de la ZAD Mauvaise Troupe a donné un nom au processus de maintien de la diversité tactique face à un ennemi commun : ils l’ont appelé « composition ». La composition est un autre nom pour le sujet collectif formé à partir des nombreuses sortes de personnes engagées dans la construction et la poursuite de l’occupation à travers toutes ses nombreuses métamorphoses. Il y a un lien évident avec la subjectivité politique relationnelle qui a caractérisé les mouvements antérieurs des années 1960 et 1970, comme dans la coalition tripartite évoquée plus haut qui a émergé à Nantes en 1968 lorsque des paysans ont rejoint des étudiants et des ouvriers en grève. Une subjectivité relationnelle d’un type similaire est certainement née de la rencontre entre les agriculteurs de la préfecture de Chiba au Japon (qui ont commencé par défendre leur mode de vie et ont appris en cours de route quel type de violence écrasante l’État leur réservait) et les étudiants et les ouvriers urbains (qui se sont déplacés pour rejoindre les agriculteurs et ont appris ce faisant pour la première fois comment et où la nourriture qu’ils mangeaient était produite). Le type de base sociale créée à la ZAD, cependant, ou lors de l’occupation de Stop Cop City à Atlanta, par exemple, était différent – essentiellement une alliance de travail, comme dans les mouvements des années 1960 et 1970 évoqués plus haut, mais qui implique également le partage au fil du temps d’un territoire physique, d’un espace de vie. Lorsque des gens d’origines et de croyances radicalement différentes se rassemblent de manière pragmatique au quotidien pour accomplir les tâches et élaborer les programmes en constante évolution d’une occupation territoriale, une sorte de communauté politique polémique se crée. La composition commence lorsque des gens d’origines différentes, avec des façons de penser différentes, des histoires et des relations différentes avec la terre, des compétences différentes et parfois une tolérance au risque très différente décident d’agir ensemble, sous prétexte d’égalité, pour défendre un territoire. Un nouveau sujet collectif – le résultat de déplacements et de désidentifications mutuels et de l’action d’égaux en tant qu’égaux – est produit, essentiellement, par la pratique, par un engagement créatif et partagé dans la construction, la défense et le maintien de la vie de l’occupation au jour le jour. Produit d’un investissement massif dans l’organisation de la vie en commun, la composition se débarrasse des types d’exclusions fondées sur des idées, des identités ou des idéologies si fréquemment rencontrées dans les milieux radicaux, de tout le sectarisme fatigué de l’histoire de la gauche. En tant que telle, c’est une manière de faire un monde, le tissage d’un nouveau type de solidarité – une solidarité où l’unité de l’expérience compte plus que la divergence des opinions, et qui amplifie également la conviction de Kropotkine selon laquelle la solidarité n’est pas une éthique ou un sentiment moral, mais plutôt une stratégie révolutionnaire, et peut-être la plus importante de toutes. Une logique de composition est à l’œuvre autant dans une occupation menée par des autochtones comme à Standing Rock que dans celle de Notre-Dame-des-Landes ou d’Atlanta. Au cœur de l’action de Standing Rock se trouvait une alliance sans précédent composée de plus de 350 nations autochtones, certaines venant d’aussi loin que l’Australie, les régions arctiques et l’Amérique centrale. Mais rien dans cette impressionnante démonstration de pan-indigénisme n’était « naturel », et on ne pouvait pas le supposer : certaines des économies tribales des nations soutenant les Sioux, par exemple, étaient elles-mêmes profondément liées à l’extraction d’énergie, notamment les Crows (charbon) et les Osages (pétrole). De profondes divisions séparaient le Conseil des Anciens (dont certains avaient des liens plus étroits que la plupart avec la communauté locale non autochtone) des jeunes occupants du camp des Guerriers rouges, qui favorisaient des actions militantes plus subversives que les anciens. Pourtant, à l’approche de l’hiver, c’est l’alliance initiale entre les tribus autochtones qui a inspiré les nombreux manifestants non autochtones – militants anti-fracturation hydraulique, actrices de cinéma, militants de Black Lives Matter, groupes religieux, vétérans de l’armée américaine – à se rendre dans le Dakota du Nord et à rejoindre l’occupation délabrée, ainsi que les nombreux qui l’ont soutenue de loin. Le processus constructif par lequel des forces aussi disparates et autonomes s’unissent et coopèrent les unes avec les autres n’est pas du tout simple. Il crée une communauté politique bien plus polémique par nature que celle qui s’efforce de parvenir à un consensus. Il ne s’agit pas d’une coalition de sujets qui restent tous les mêmes tout au long du mouvement, car la composition ne crée pas d’uniformité ni ne laisse les groupes ou les individus inchangés. Les nouveaux arrivants à l’occupation de Standing Rock, par exemple, trouveraient certainement leur identité d’écologistes blancs, par exemple, décentrée, c’est le moins qu’on puisse dire. Pourtant, si la composition crée des points communs, elle ne cherche pas à homogénéiser les multiples segments du mouvement. La cohésion face à un ennemi commun ne se traduit pas par une orthodoxie, mais plutôt par un éclectisme interne et une diversité de méthodes qui perdurent. Ainsi, comme le remarque Lefebvre, l’allergie des partis politiques à ce type de mouvements territoriaux est aussi bien réelle que l’inverse : le sentiment est réciproque. La diversité des méthodes, ou la « complémentarité des pratiques », comme on l’appelle, est une part essentielle de l’égalité supposée entre les différentes composantes du mouvement. Une composition aussi diverse lui permet de s’exprimer à travers divers types d’actions ; à la ZAD, il s’agissait notamment de déposer des plaintes, de construire et de maintenir des liens avec des groupes de soutien éloignés, de faire du graphisme, d’affronter frontalement la police, de répertorier les espèces en voie de disparition sur la zone et de saboter des machines. Aucune méthode n’était présumée supérieure à une autre ; ni la légalité ni l’illégalité, ni la violence ni la non-violence n’étaient fétichisées. Les partisans d’une méthode s’abstenaient d’argumenter sur la supériorité de leur méthode. Ainsi, certains segments peuvent se retrouver à apporter des contributions plus visibles ou à intervenir plus bruyamment à certains moments, tout en restant récessifs à d’autres ; dans ce dernier cas, comme dans une composition musicale, d’autres instruments sont là pour reprendre la mélodie. Le mouvement ne met jamais tous ses œufs dans le même panier. Sa force, surtout face à un État qui tente sans cesse de diviser pour mieux régner en opposant un groupe à un autre, tient en grande partie à la complémentarité des méthodes.
Une logique de composition est à l’œuvre autant dans une occupation menée par des autochtones comme à Standing Rock que dans celle de Notre-Dame-des-Landes ou d’Atlanta. Au cœur de l’action de Standing Rock se trouvait une alliance sans précédent composée de plus de 350 nations autochtones, certaines venant d’aussi loin que l’Australie, les régions arctiques et l’Amérique centrale. Mais rien dans cette impressionnante démonstration de pan-indigénisme n’était « naturel », et on ne pouvait pas le supposer : certaines des économies tribales des nations soutenant les Sioux, par exemple, étaient elles-mêmes profondément liées à l’extraction d’énergie, notamment les Crows (charbon) et les Osages (pétrole). De profondes divisions séparaient le Conseil des Anciens (dont certains avaient des liens plus étroits que la plupart avec la communauté locale non autochtone) des jeunes occupants du camp des Guerriers rouges, qui favorisaient des actions militantes plus subversives que les anciens. Pourtant, à l’approche de l’hiver, c’est l’alliance initiale entre les tribus autochtones qui a inspiré les nombreux manifestants non autochtones – militants anti-fracturation hydraulique, actrices de cinéma, militants de Black Lives Matter, groupes religieux, vétérans de l’armée américaine – à se rendre dans le Dakota du Nord et à rejoindre l’occupation délabrée, ainsi que les nombreux qui l’ont soutenue de loin. Le processus constructif par lequel des forces aussi disparates et autonomes s’unissent et coopèrent les unes avec les autres n’est pas du tout simple. Il crée une communauté politique bien plus polémique par nature que celle qui s’efforce de parvenir à un consensus. Il ne s’agit pas d’une coalition de sujets qui restent tous les mêmes tout au long du mouvement, car la composition ne crée pas d’uniformité ni ne laisse les groupes ou les individus inchangés. Les nouveaux arrivants à l’occupation de Standing Rock, par exemple, trouveraient certainement leur identité d’écologistes blancs, par exemple, décentrée, c’est le moins qu’on puisse dire. Pourtant, si la composition crée des points communs, elle ne cherche pas à homogénéiser les multiples segments du mouvement. La cohésion face à un ennemi commun ne se traduit pas par une orthodoxie, mais plutôt par un éclectisme interne et une diversité de méthodes qui perdurent. Ainsi, comme le remarque Lefebvre, l’allergie des partis politiques à ce type de mouvements territoriaux est aussi bien réelle que l’inverse : le sentiment est réciproque. La diversité des méthodes, ou la « complémentarité des pratiques », comme on l’appelle, est une part essentielle de l’égalité supposée entre les différentes composantes du mouvement. Une composition aussi diverse lui permet de s’exprimer à travers divers types d’actions ; à la ZAD, il s’agissait notamment de déposer des plaintes, de construire et de maintenir des liens avec des groupes de soutien éloignés, de faire du graphisme, d’affronter frontalement la police, de répertorier les espèces en voie de disparition sur la zone et de saboter des machines. Aucune méthode n’était présumée supérieure à une autre ; ni la légalité ni l’illégalité, ni la violence ni la non-violence n’étaient fétichisées. Les partisans d’une méthode s’abstenaient d’argumenter sur la supériorité de leur méthode. Ainsi, certains segments peuvent se retrouver à apporter des contributions plus visibles ou à intervenir plus bruyamment à certains moments, tout en restant récessifs à d’autres ; dans ce dernier cas, comme dans une composition musicale, d’autres instruments sont là pour reprendre la mélodie. Le mouvement ne met jamais tous ses œufs dans le même panier. Sa force, surtout face à un État qui tente sans cesse de diviser pour mieux régner en opposant un groupe à un autre, tient en grande partie à la complémentarité des méthodes.