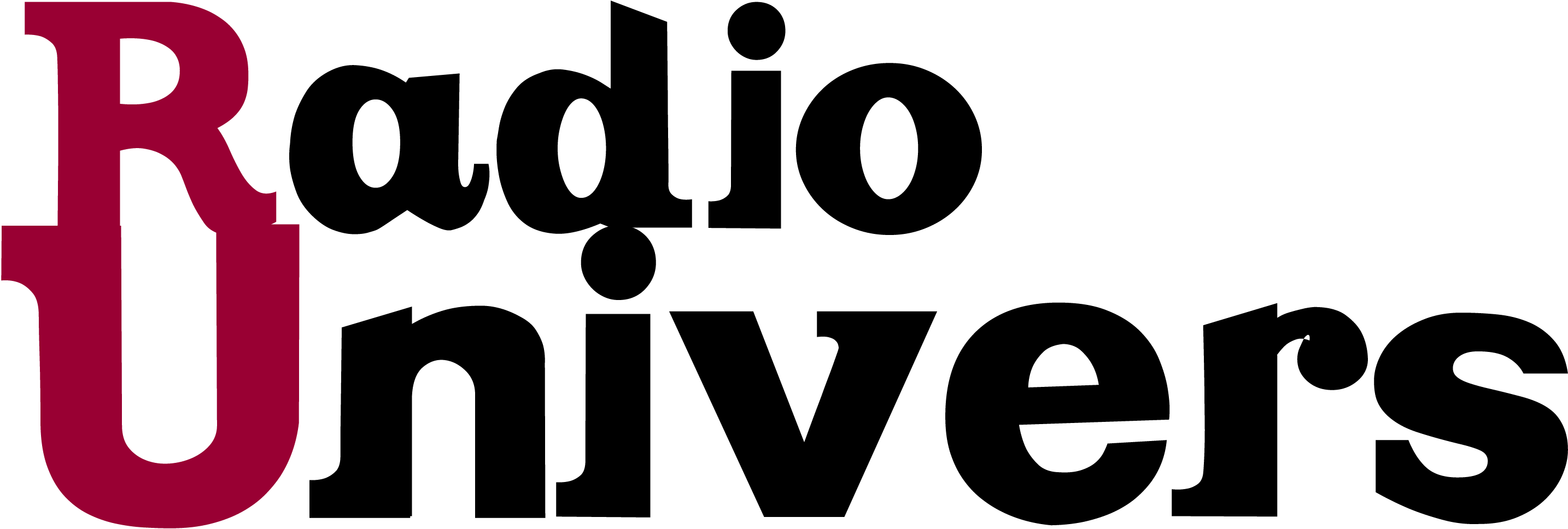Monument et mémoire vive. N°618
Écrit par D.D sur 12 février 2014
 Une confidence. J’ai été touché par la disparition de Cavanna. Je possède seulement une dédicace de lui apposée sur l’album Sur les murs de la classe offert par notre amie Françoise à l’occasion du Festival Etonnants voyageurs 2004 de Saint-Malo. En soi c’est déjà une bonne raison d’y être. Mais pas seulement. Bien sûr j’ai lu souvent Charlie-Hebdo dans les années 70, mais ce n’est pas le principal. Ou plutôt si. Cette bande de dessinateurs et de journalistes nous avait donné le goût, la passion pour la presse alternative dite de contre-information, faite d’une centaine de petits journaux contestataires à la camaraderie bouillonnante dans la France de l’époque (en des temps cadenassés)-dont ici encore aujourd’hui nous revendiquons la filiation.
Une confidence. J’ai été touché par la disparition de Cavanna. Je possède seulement une dédicace de lui apposée sur l’album Sur les murs de la classe offert par notre amie Françoise à l’occasion du Festival Etonnants voyageurs 2004 de Saint-Malo. En soi c’est déjà une bonne raison d’y être. Mais pas seulement. Bien sûr j’ai lu souvent Charlie-Hebdo dans les années 70, mais ce n’est pas le principal. Ou plutôt si. Cette bande de dessinateurs et de journalistes nous avait donné le goût, la passion pour la presse alternative dite de contre-information, faite d’une centaine de petits journaux contestataires à la camaraderie bouillonnante dans la France de l’époque (en des temps cadenassés)-dont ici encore aujourd’hui nous revendiquons la filiation.
En effet, cette presse parallèle irrévérencieuse, une multiplication des petites inventions en papier journal aujourd’hui disparues, fut si proche dans l’esprit et le propos de l’équipe de Charlie-Hebdo, donc de Cavanna entre autres, qu’il me reste cet attachement. D’où cette peine. Je tenais à le dire. Nous reste à relire ses coups de gueule comme cette prémonitoire Lettre de Cavanna aux culs-bénits.
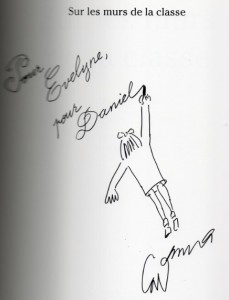
Rappelons que Desproges comparait Cavanna à un « Rabelais moderne ».
Comme une page qui se tourne. C’est l’effet que ça me fait à l’heure de l’éventuelle disparition de Libération, autre journal des années 70. Soit l’histoire de « plus quarante ans de vie démocratique, de combats intellectuels, de résistance de la pensée » (Cynthia Fleury). Un quotidien avec lequel je vis depuis ses débuts, en qualité d’être l’un de ses plus anciens abonnés. Ces temps-ci, oui, la bêtise et le retour à l’ordre des dominants semblent avoir la main lourde.
Lue aussi par Françoise de Lieux-dits -qui me la signale- dans le dernier livre coup de gueule de Jean Ziegler cette phrase de Gilles d’Elia : « le dernier moment de la colonisation consiste à coloniser l’histoire du colonialisme. » Et d’une manière générale j’aime bien le terme de colonisation quand il s’agit des esprits asservis. Souvent on dit de tel ou tel manager qu’il a l’esprit formaté, conditionné. Mais ça fait appel à une sorte de technique, de programmation de disque dur, etc. Là quand on dit « colonisation » il y a toute la domination dont parle Bourdieu. Avec souffrance imposée et humiliation du dominant qui détruit l’autre.
Cette question de la colonisation de l’histoire m’amène tout doucement à poursuivre le cycle Dollé. Par un long entretien qu’il avait accordé sur les façons communes de se souvenir.
« Monument et mémoire vive.
LDP : Pour commencer, je voudrais que l’on parle des monuments et de leurs rapports à la mémoire. Ce qui relève de la mémoire, surtout lorsqu’il s’agit d’une mémoire tragique, garde toujours quelque chose d’assez intransmissible comme tel. Or, tout monument ne participe-t-il pas à une entreprise de refoulement de la mémoire dans la mesure où il sert à commémorer un événement réel, caractérisé par le morcellement des corps, les ruines et les gravas, mais se présente lui-même comme totalité érigée ? Là où le réel est au fond plutôt du côté du morcellement, le monument semblerait avoir une tendance à faire oublier ça.
J-P Dollé : Oui, mais le « monument » n’est pas d’abord architectural. Le monument, c’est ce qui fait souvenir. Donc il peut y avoir toutes sortes de monuments. Il se trouve –et ce n’est sans doute pas un hasard- que lorsqu’on emploie ce mot dans le langage courant, on pense au monument édifié dans un espace, à quelque chose de l’ordre d’une construction, d’un bâti quelconque. On pense au monument comme à ce qui se montre pour faire souvenir ; mais un monument peut aussi être de l’ordre de l’écoute, ou de la vision littéraire- des textes peuvent fonctionner comme des monuments.
Le type classique est le « monument aux morts ». Que signifie faire des monuments aux morts ? ça ne peut être qu’une métonymie, une toute petite partie de ce qui concerne ces morts dont il faudrait se souvenir. Donc, si l’on file votre comparaison, il est vrai que le monument en tant que « monumental » fixe et fige. Il peut alors avoir une fonction d’annihilation ou de manipulation de la mémoire. D’ailleurs, en général, le monumental, c’est fait pour ça : pour forcer un certain regard sur la mémoire, et d’abord sur les morts qu’on choisit d’honorer ou pas. Dans le monumental, c’est la mort héroïque qui est commémorée, et il y a toujours là la manipulation plus ou moins explicite d’un pouvoir.
LDP : Au fond, cela serait toujours le cas. Il y a évidemment des degrés dans le monumental : en Union Soviétique, par exemple, comme dans tous les régimes totalitaires, on avait des monuments « monumentaux »… Mais je me demandais si même concernant les plus petits monuments, il n’y a pas toujours quelque chose d’irreprésentable qui y est dissimulé. De ce fait même, le monument architectural n’est-il pas toujours voué à refouler ce qu’il veut précisément commémorer ?
J-P D : Certainement. Qu’il soit architectural ou sculptural, il est vrai que le monument au mieux colmate, au pire refoule et même empêche, inhibe la mémoire. Plus encore : il peut radicalement la transformer ou la travestir. De la mémoire d’une défaite, on peut faire la mémoire d’une victoire ; de la mémoire d’une atrocité, on peut faire une gloire. La mémoire est une arme. Le monumental relève toujours de l’ordre du pouvoir. C’est vrai y compris du pouvoir privé : si l’on prend l’exemple d’une tombe, il ne s’agit pas d’un pouvoir politique, collectif, mais de celui d’une famille qui peut mettre en scène la manière dont elle veut qu’on se souvienne de ses morts. C’est une politique familiale qui a été beaucoup pratiquée dans les cimetières.
LDP : Justement, si ce qui se montre est toujours plus ou moins fautif, c’est sans doute autrement qu’on doit procéder pour produire une effet commémoratif. Il me semble qu’il y a un artiste qui a brillamment réussi à commémorer la Shoah, Jochen Gerz. Il a élaboré une œuvre, le « Monument invisible » (1993), devant le château de Sarrebrück –qui fut l’un des sièges de la Gestapo –en Allemagne. Pour ce monument, il a dépavé 2600 pierres sur les 8000 formant le site, et inscrit sur chacune un nom pris dans un cimetière juif profané par les nazis. Puis il a remis chaque pavé en place, avec l’inscription retournée, de sorte qu’il est impossible au promeneur de savoir s’il marche ou non sur un pavé gravé. On a donc, dans cette œuvre commémorative, une invisibilité et un morcellement qui se maintiennent. Il ne prétend pas montrer ce qui est de toute façon irreprésentable, et en même temps, une inscription symbolique est là. L’événement est là présenté de façon tout à fait pertinente semble-t-il.
J-P D : Oui, et c’est très difficile de trouver des façons adéquates de commémorer des événements tragiques sans les perdre. On a là une manière cohérente de procéder. La question se pose aujourd’hui de plus en plus de savoir comment représenter l’irreprésentable. Cette manière est juste, modeste, et tout à fait adéquate.
LDP : Le problème est peut-être qu’à partir du moment où il y a monument, on peut se sentir quitte avec sa mémoire : s’il y a un monument qui est là pour se rappeler à notre place, il n’est plus nécessaire que la mémoire soit maintenue vivante. Parce qu’elle est inscrite dans la pierre, externalisée, elle ne nous concerne plus.
J-P D : Si on met en rapport l’architecture et le monumental, on prend déjà parti sur la question. On peut, de ce point de vue, s’opposer radicalement à l’architecture. Certains penseurs adoptent cette position radicale : l’essence de l’architecture serait d’être monumentale. A la suite de Hegel, on peut poser que l’architecture est par essence au service du pouvoir. La forme du pouvoir c’est son monument, et le monument a lui-même pour finalité d’écraser. Le monument, c’est toujours la mémoire des puissants qui écrasent ceux qui y ont été soumis, dominés. Hegel ne va pas jusque là, même s’il met en rapport l’architecture et le pouvoir. Par contre, au XIXè siècle et plus encore au XXè siècle, des penseurs –en général des écrivains- affirment expressément que l’architecture monumentale est un geste de domination : Walter Benjamin, pour la pensée allemande, ou en France, Bataille qui attaque frontalement l’architecture et considère que l’architecture = le monumental = la domination = le pouvoir= l’oppression. Dans l’architecture démocratique cela apparaît nettement.
On avait déjà dénoncé cet état de fait au moment de la Révolution française : toute une fraction du dévouement révolutionnaire entre 1789 et 1795 s’attaquait frontalement à l’architecture –grands monuments, palais- et aux architectes. Mona Ozouf raconte un épisode tout à fait révélateur à cet égard. La forme à donner à la commémoration du 14 juillet 1789, c’est-à-dire à la destruction d’un édifice monumental, n’allait pas de soi. En 1790, les Constituants veulent pourtant commémorer le 14 juillet 1789. Ils demandent donc à une commission de l’Académie royale des Beaux-Arts composée d’architectes et de peintres de réfléchir sur la manière de commémorer, par un monument, la prise de la Bastille. A chaque fois qu’un projet est présenté par la commission, il est mis de côté. Finalement, ce ne sont pas du tout les « spécialistes » qui trouvent la solution, c’est l’initiative spontanée du peuple. Lors de l’épisode connu sous le nom de « journée des brouettes », en mai ou juin 1790, le peuple de Paris est appelé à aménager le Champ-de-Mars. Et l’idée surgit que le monument de la Fédération ne sera pas un édifice, mais des gens, une assemblée de personnes.
LDP : C’est en fait le premier art éphémère de l’histoire…
J-P D : Voilà. La fête de la Fédération trouve son monument en elle-même. Il fallait trouver un désert dans la ville et c’est au Champ-de-Mars que le monument s’est organisé, le monument pour faire souvenir, monumentum. On peut voir là une attaque de l’idée selon laquelle un monument devrait nécessairement être matériel et visible. On oppose à cela l’idée que le monument, c’est des gens qui s’assemblent et se disperseront.
LDP : Mais alors plus de trace du monument commémoratif.
J-P D : C’est une idée importante car elle correspond également à la conception qu’on peut se faire de ce qu’est la ville comme monument. Ce qui est important, ce ne sont pas les monuments dans la ville, c’est la ville elle-même comme monument. La ville est faite de strates. Face à ce qu’ont toujours été le monument et le monumental, qui sont intrinsèquement liés au pouvoir, plus ou moins despotique, autoritaire, ou même totalitaire, il y a la ville, parce que la ville est immaîtrisable. Plus la ville est grande, moins elle est maîtrisable. La ville est à elle-même son « souviens-toi ». Une question se pose alors : si une ville se définit notamment par sa faculté commémorative, que doit-elle être pour se maintenir ?
LDP : Certaines villes comme Florence ou Venise par exemple, ont tendance à devenir des « villes-musées »…
J-P D : Oui, mais alors ce ne sont justement pas des villes-mémoires… Elles se transforment en leur contraire. C’est le bon mot : ce sont des « villes-musées ». Et c’est contradictoire dans les termes. Il peut bien y avoir des musées dans la ville, mais quand une ville devient musée, ce n’est plus une ville. Une ville fonctionne parce qu’il y a de la circulation, au sens le plus concret du terme. Qu’on puisse y accéder et y circuler, voilà ce qui fait une ville. Une ville, c’est un certain espace relativement limité, où il y a un quantum d’habitants et dans laquelle circulent des marchandises et des êtres humains, éventuellement des animaux. Qui dit « circulation », dit « êtres vivants », commerce de marchandises, commerce amoureux, brassage. Pour qu’il y ait une ville, il faut qu’il y ait du « vivant multiple » selon la formule d’Hannah Arendt. Plus une ville a un caractère urbain, plus elle est diverse. Dans les « villes-musées », il n’y a plus du tout ça.
LDP : Elles ont une spécificité…Il n’y a que des touristes, des restaurateurs, des échoppes de souvenirs.
J-P D : Ces villes sont bel et bien monoculturelles. Il y a des musées et des touristes. Cette situation nous guette à Paris. Le risque est cependant moindre parce qu’il y a encore des travailleurs clandestins, des activités immaîtrisées… Une ville doit maintenir des espaces incontrôlés même si on la fantasme paradoxalement comme un refuge. Mais à partir du moment où elle se renferme sur une activité, ce n’est plus une ville.
LDP : On peut ainsi opposer une mémoire vivante de la ville à sa mémoire morte, une mémoire qui touche un réel à une mémoire refoulante ?
J-P D : Il y a en effet différents usages de la mémoire. La mémoire, c’est ce qu’il y a de plus intime pour chacun d’entre nous : chacun a sa mémoire. Le paradoxe, c’est de faire que l’on puisse reconnaître ce qu’il y a de plus intime en soi, de sa mémoire, dans ce qui est présenté en littérature –Proust est le cas emblématique du XXè siècle –en peinture ou en architecture. Il faut que l’on puisse se retrouver dans ce qui est présenté dehors –c’est-à-dire dans la ville qui n’est pas soi, qui est extérieure au citadin – il faut que l’on puisse s’y reconnaître, et même plus que ça : s’y connaître.
LDP : Qu’une ville nous révèle à nous-mêmes, en somme.
J-P D : Oui, c’est ça, qu’elle nous révèle à nous-mêmes. Et dans un autre sens, que ce qui n’avait strictement rien à voir avec notre vie, qui n’était pas du tout notre mémoire, s’agrège à ce qu’il y a de plus privé en nous. Ce sont les rapports qu’il faut examiner de près entre la mémoire et l’histoire. L’histoire peut devenir un élément de notre mémoire. Dans la vie et les souvenirs personnels de chacun, il peut y avoir des souvenirs historiques, et même bien entendu, des souvenirs historiques que l’on n’a pas vécus. Sont intégrées dans ma mémoire l’histoire de la philosophie, l’histoire de l’art, l’histoire de la psychanalyse. Cette mémoire est vivante si je m’en sers ; alors seulement elle se fait présent futur…
LDP : La mémoire ne saurait être pétrifiée sans se perdre, sans indiquer un « ne rien vouloir savoir ».
J-P D : C’est ça. On peut faire en sorte que le passé soit trépassé, annihilé. C’est ce qui se passe en ce moment à bien des égards. Ce n’est pas simplement qu’on oublie le passé, mais on oublie encore l’oubli. A ce sujet, il y a un texte magnifique de Perce –W ou le souvenir d’enfance- à partir duquel un film a été fait par Robert Bober : En remontant la rue Vilin. Chaque année, Perec remontait la rue Vilin à Ménilmontant. C’est là qu’il était né. Il pouvait y voir des changements, des signes de disparition, jusqu’au jour où il n’y eut plus rien. Sur cette rue, on a fait un square ; elle n’existe plus, elle a disparu. Une chose disparaît non pas quand elle est passée, mais quand on ne sait même plus qu’elle a existé. Quand on fait disparaître les traces, il n’y a plus rien. Evidemment, le cas emblématique de cette logique, c’est la Shoah, puisqu’il fallait que tout disparaisse, y compris les traces. Mais beaucoup de villes ont été concernées par ces phénomènes de disparition des traces : les villes rasées en sont un exemple. C’est le contraire d’une question de patrimonialisme. Est-il bon, non pas de faire revivre ce qui n’existe plus –ce qui serait absurde –mais de faire en sorte qu’un souvenir de ce qui a été détruit persiste ? Le vrai monumentum, ce n’est pas d’ériger des monuments, mais de faire en sorte qu’existe la trace et y compris la trace de la destruction. La mauvaise manière de résoudre cette question concrète de la mémoire dans la ville consiste soit à tout détruire, soit à tout garder.
LDP : Je vous sais intéressé aux problèmes politiques, aussi permettez cette question. Vous affirmez à maintes reprises –notamment dans « l’Enfant et le patrimoine » – qu’il n’y a rien de plus privé que la mémoire, j’en conviens. Cependant, il y a aussi une histoire collective sans laquelle il n’y aurait pas de cité, de communauté politique. Il est bien nécessaire que chaque Français considère Clovis, Henri IV, la Révolution française, l’affaire Dreyfus comme des moments de son histoire. Et pourtant une difficulté se fait jour depuis quelques années : ce qu’on appelle la « concurrence des mémoires » sévit, comme si deux moments de l’histoire de France ne pouvaient pas coexister dans la mémoire collective.
J-P D : Cela pose la question du commun. Le commun suppose de fait le partage. Dans le cas très précis que vous posez et qui concerne un problème tout à fait fondamental, la question est de savoir ce qu’est une assemblée de citoyens. La leçon de la cité grecque est toujours valable à cet égard : pour qu’il y ait du koinos, il faut un langage commun –pas seulement une langue, l’idiome, mais un fond commun à partager.
LDP : D’une part, il est évidemment très difficile de demander à chaque citoyen français de reconnaître l’histoire de France si l’Etat français fait des décrets pour reconnaître le rôle positif de la colonisation. Mais il est d’autre part difficile aussi de poser des conditions à cette reconnaissance de l’histoire de France.
J-P D : Pour tous les ex-colonisés de l’empire français, il faut qu’il y ait une histoire de la République française, qui soit une histoire valant pour chacun. Ça suppose de faire partager à tous ceux qui décident d’être Français –puisque la décision est le fondement de la citoyenneté- une histoire commune. « Tu t’intègres et partages avec tous les autres la même histoire. » Dans l’histoire de la République française, toutes ces mémoires-là doivent faire l’Histoire. La seule manière de sortir de la « guerre des mémoires » à laquelle on assiste malheureusement est de faire une histoire commune. Tous doivent accepter cette histoire commune, ou alors, ceux qui s’y refusent se mettent en dehors du commun, mais c’est eux qui le choisissent. Très concrètement, dans les livres d’histoire que tous les écoliers apprennent, il faut qu’il soit fait l’histoire de tous les moments de l’histoire de la République, y compris l’histoire de la colonisation. Qu’il en soit fait l’histoire est une condition de la reconnaissance de l’histoire de France comme valant pour chacun.
LDP : Au fond, vous diriez qu’une histoire officielle menteuse permettrait en droit à certains de dire « je ne me soumets pas »…
J-P D :L’absence d’histoire est la justification –non pas l’excuse- de la guerre des mémoires. C’est pour cela que je ne suis pas partisan du « devoir de mémoire », mais du « devoir d’histoire ». »
Jean-Paul Dollé, philosophe -« Le Diable Probablement. » N°3- décembre 2007.
Hum! J’ouvre la parenthèse. Sans vouloir gâcher l’idée.
Tenez ! Prenez Jacques Rancière.
» Le monument, écrit-il, est ce qui parle sans mots, ce qui nous instruit sans intention de nous instruire, ce qui porte mémoire par le fait même de ne s’être soucié que de son présent » («L’inoubliable » -1997 : p 55)
Ainsi renvoie-t-il à l’art: » Il n’y a pas d’œuvre d’art vivante ou totale qui s’identifierait à la grande communauté unie par un même souffle ou une même vision. Les seules communautés qui valent sont les communautés partielles et toujours aléatoires qui se construisent dans l’attention qu’une oreille prête à une voix, qu’un regard porte sur une image, une pensée sur un objet, dans le croisement des paroles et des écoutes attentives aux histoires des uns et des autres, dans la multiplication des petites inventions, toujours menacées de se perdre dans la banalité des objets ou des images si des inventions nouvelles ne réveillent pas le potentiel qui est en elles. Ce n’est pas affaire de bons sentiments. C’est affaire d’art, c’est-à-dire de travail et de recherche pour donner une forme singulière à la capacité de faire et de dire qui appartient à tous. »
 Tenez ! Encore. Sans vouloir trop gâcher l’idée. Prenez Cavanna.
Tenez ! Encore. Sans vouloir trop gâcher l’idée. Prenez Cavanna.
C’est justement pour avoir de son vivant « donner une forme singulière à la capacité de faire et de dire qui appartient à tous», mais aussi par tous les combats qu’il a menés pour la liberté d’expression, que sa mort m’a affecté autant. C’était un monument de mémoire vive. Comme en témoigne cet album dans lequel Cavanna, ce fils d’émigré italien, s’aidant de ses propres souvenirs de la communale, retrace avec humour la vie des écoliers qui ont été à tout jamais marqués par les planches cartonnées accrochées sur les murs de la classe: cartes de géographie, d’histoire de France, de sciences nat’, etc.
Sur ce, et en sa mémoire je ferme la parenthèse.
D.D