Tim Ingold, « La corde et la pile. » N°1212
Écrit par admin sur 6 août 2025
Les mois passent et l’auteur de La Chronique d’ici-même maintient son temps d’attention précieux avec les générations qui le précédent, par l’exploration des reliques du temps passés déjà énoncées ici. Et en ces heures-ci à l’occasion de la mise à la ferraille de vieux outils et machines à coudre le cuir, exhumés de coins et recoins oubliés. Stockés suivant le bon vieux principe tombé en désuétude: garder, ça peut toujours servir.
Si bien que pareille activité immergée dans l’ancien monde amène à réfléchir sur l’obsolescence des choses et des humains catégorisés en telle ou telle étagère de rangement social. Soit en symbiose et au diapason dans des strates les plus ingrates d’une époque rationalisée et dite efficace, ou soit déclassés de celle-ci par effet de jeunesse ou par des années empilées poussées à sombrer.
Retour donc ce jour à l’un des penseurs préférés de cette chronique réaliste, à savoir l’anthropologue écossais Tim Ingold. Un retour qui n’a rien d’anachronique quoique son dernier ouvrage » Le passé à venir -repenser l’idée de génération » en donnerait l’impression. Pareille considération serait pour lui « à la base de notre impression que le monde est parfois une voie sans issue ».
C’est en tout cas le voeu d’Ingold que de nous replacer face à cette question : ne serions-nous que des couches successives de générations qui s’empilent ?
Mais d’abord, c’est la moindre des politesses qu’on doit à notre amie Françoise de Lieux-dits.eu, que de publier sans tarder ses pages choisies. Car, par un envoi, elle nous alerte sur la vigueur de ce long texte tiré du livre en question.
Imaginez que vous êtes en train de fabriquer une corde. Comme matière première, vous avez récolté une certaine quantité de brins d’herbe dans des prés. Pour former la corde, vous effectuez un double mouvement. D’abord, vous devez entortiller les brins d’herbe, préalablement alignés sur leur longueur, pour former des torons, que vous enroulez à leur tour les uns autour des autres, en sens inverse. La solidité de la corde vient de l’opposition entre les deux torsions, celle des torons devant être inverse à celle de leur enroulement. Le couple de torsion des torons, qui, laissés seuls, auraient tendance à se détendre, renforce la tension de leur enroulement qui, en retour, resserre les torons eux-mêmes. Ce sont ces forces opposées, associées à la friction sur leur longueur des brins d’herbe constituant les torons, qui permettent à la corde de ne pas s’effilocher et lui donnent sa capacité de résistance à la traction. Bien évidemment, les brins d’herbe ont une longueur finie. Mais en introduisant de nouveaux brins d’herbe dans l’enroulement, la corde elle-même peut se poursuivre indéfiniment – ou du moins jusqu’à ce que vous ayez épuisé votre stock de matière première. Lorsque celui-ci touche à sa fin, vous devrez peut-être patienter pendant une saison, le temps que l’herbe pousse. Ensuite, avec une nouvelle récolte, vous pourrez reprendre là où vous vous étiez arrêté.
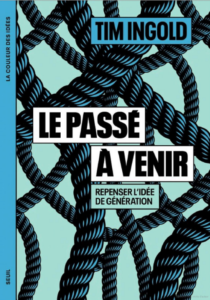 Imaginez maintenant que chaque brin d’herbe est une vie. Pas nécessairement une vie humaine, mais supposons pour l’instant que ce soit le cas nous savons par expérience qu’une vie humaine ne se vit généralement pas de manière isolée, mais en compagnie d’autres que soi. Les humains cheminent en groupe et leurs vies se tissent les unes autour des autres, en particulier dans le contexte intime du foyer et de la famille. Et ces rassemblements domestiques, à leur tour, évoluent ensemble dans les circulations plus larges de la vie sociale. Les vies humaines s’enroulent les unes autour des autres, conférant à la vie sociale une certaine cohésion et l’empêchant de s’effilocher. La tendance des vies particulières à suivre leur propre voie distincte provoque une friction qui resserre les liens de la communauté ; inversement, tout relâchement de ces derniers renforce l’intimité dans laquelle ces vies se côtoient. Le contrepoint entre tension et friction – ce que les Grecs anciens appelaient l’harmonie (armonia) – assure la cohésion de l’ensemble. Personne, bien sûr, ne vit éternellement. Mais à mesure que certains vieillissent et finissent par s’éteindre, d’autres naissent et entrent dans la spirale. Ainsi, malgré le remplacement des individus participants, la vie sociale peut se poursuivre indéfiniment, suivant un rythme qui naît du cycle des générations humaines.
Imaginez maintenant que chaque brin d’herbe est une vie. Pas nécessairement une vie humaine, mais supposons pour l’instant que ce soit le cas nous savons par expérience qu’une vie humaine ne se vit généralement pas de manière isolée, mais en compagnie d’autres que soi. Les humains cheminent en groupe et leurs vies se tissent les unes autour des autres, en particulier dans le contexte intime du foyer et de la famille. Et ces rassemblements domestiques, à leur tour, évoluent ensemble dans les circulations plus larges de la vie sociale. Les vies humaines s’enroulent les unes autour des autres, conférant à la vie sociale une certaine cohésion et l’empêchant de s’effilocher. La tendance des vies particulières à suivre leur propre voie distincte provoque une friction qui resserre les liens de la communauté ; inversement, tout relâchement de ces derniers renforce l’intimité dans laquelle ces vies se côtoient. Le contrepoint entre tension et friction – ce que les Grecs anciens appelaient l’harmonie (armonia) – assure la cohésion de l’ensemble. Personne, bien sûr, ne vit éternellement. Mais à mesure que certains vieillissent et finissent par s’éteindre, d’autres naissent et entrent dans la spirale. Ainsi, malgré le remplacement des individus participants, la vie sociale peut se poursuivre indéfiniment, suivant un rythme qui naît du cycle des générations humaines.
L’analogie, évidemment, n’est pas parfaite. La différence la plus importante entre la corde et la vie sociale est certainement que la première se fabrique en utilisant des matériaux déjà rassemblés, alors que la seconde se fait au fur et à mesure, à partir de vies qui ne cessent de se créer depuis l’extrémité. Il serait peut-être plus approprié de comparer ces dernières à des lianes ou à des plantes grimpantes qui s’enroulent les unes autour des autres pour se frayer un chemin dans un enchevêtrement touffu de végétation. Les nouvelles vies ne sont pas introduites de l’extérieur – comme le sont les brins d’herbe dans le tressage d’une corde – mais naissent de l’intérieur, de la même manière qu’avant la récolte, de nouvelles pousses naissent de vieilles tiges. Néanmoins, je trouve l’image de la corde utile comme point de départ pour réfléchir à la génération de la vie sociale. C’est le sujet de ce livre. Mes questions sont simples. Qu’est-ce qui, dans le passage des générations, vient avant et qu’est-ce qui vient après ? Nos ancêtres nous précèdent-ils ou nous suivent-ils ? Qu’en est-il pour les descendants ? Comment la vie sociale perdure-t-elle pour assurer sa propre continuité ? Mais les réponses sont de la plus haute importance, surtout à une époque où cette continuité, ou perdurance, semble plus que jamais menacée.
Je crois que cette menace, ou du moins la perception que nous en avons, doit beaucoup au penchant très prononcé de notre époque à faire glisser l’attention de la génération de la vie sociale vers les générations. Et ce pluriel revêt une importance capitale ! La génération est un processus – un engendrement de la vie, non seulement au moment de la conception ou de la naissance, mais également à chaque instant de l’existence. Vivre, comme nous le verrons, c’est ce que nous faisons, mais c’est aussi ce que nous subissons car, en nous enroulant les uns aux autres, nous nous générons activement nous-mêmes et les uns les autres. Alors que les générations, au pluriel, sont comme des tranches coupées au travers du processus de la vie : chacune représente une cohorte d’humains qui a pris rang à un moment ou dans un intervalle de temps donné, dont les membres se considèrent ou sont perçus d’une certaine manière, comme partageant une expérience commune d’une époque, et dont la formation est complètement établie dès le début. La marche de ces cohortes ne se caractérise pas par la continuité, mais par des remplacements en série. Chaque génération entre en scène à son tour pour, après avoir joui de sa part de lumière, se retrouver recouverte par celle qui lui succède et sombrer dans le passé. La génération se poursuit, tandis que les générations s’empilent, étage par étage, couche par couche, pour former une pile.
Ce type de pensée stratigraphique est profondément ancré dans les sensibilités modernes et conduit à assimiler facilement la superposition des générations aux couches de sédimentation dans l’histoire de la Terre, aux dépôts dans les sites archéologiques, aux documents conservés dans les archives, et même à la conscience dans l’esprit humain. Cette façon de penser s’est imposée, souvent de manière subreptice, dans tous les domaines où entrent en jeu les passés et les futurs humains, qu’il s’agisse de tradition et de patrimoine, de conservation et d’extinction, de soutenabilité et de progrès, ou encore d’art et de science. Dans les chapitres suivants, nous verrons comment cela s’est produit. Remplacer la métaphore de la pile par celle de la corde permet d’apporter une lumière totalement différente sur ces questions. Comme l’illustre la figure 1.1, dans le cas de la pile, chaque génération est appelée à remplacer la précédente. Avec la corde, les jeunes vies se chevauchent avec les plus anciennes, et le vivant lui-même se trouve régénéré par leur collaboration, qui ne se limite d’ailleurs pas à celle des vies humaines, puisqu’elle s’étend aux relations entre les êtres vivants de toute nature. Ce n’est selon moi qu’en repensant la génération en ces termes que nous pourrons jeter les bases d’une coexistence durable. »
FIGURE 1.1 – La corde et la pile, en cinq générations.» (de «Le passé à venir: Repenser l’idée de génération).
D.D
![]() Ce qui a été dit et écrit ici-même autour de Tim Ingold.
Ce qui a été dit et écrit ici-même autour de Tim Ingold.
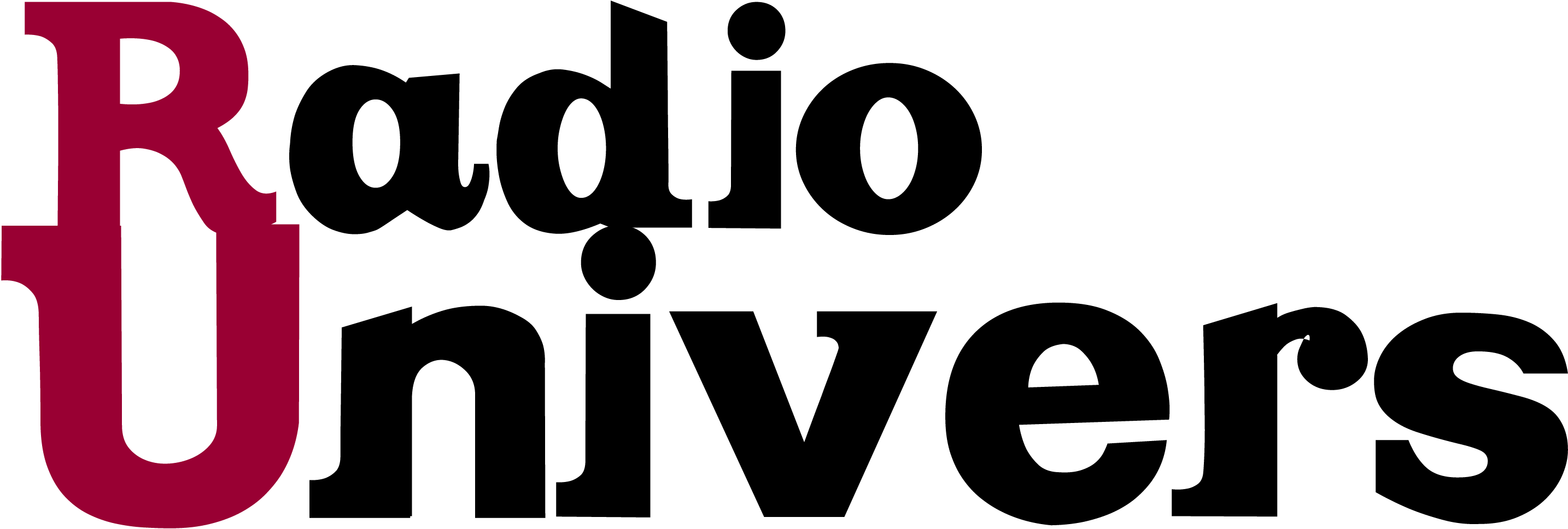

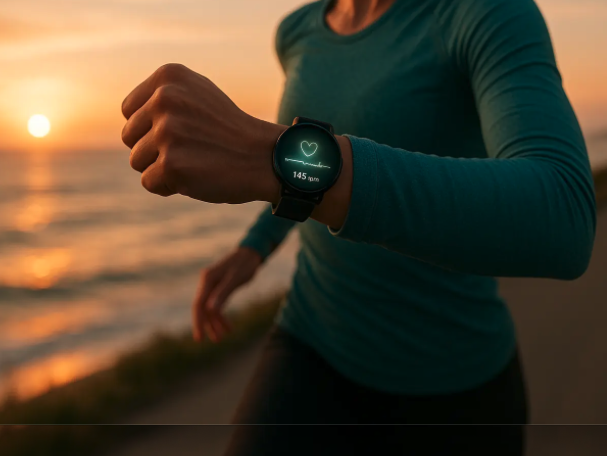
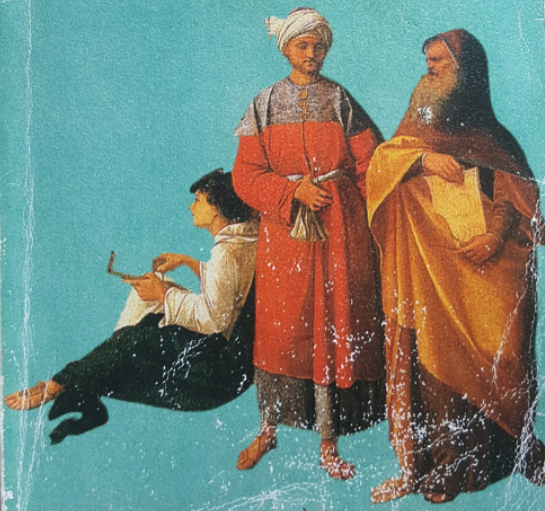



Françoise Sur 6 août 2025 à 20 h 46 min
Ce qui me plaît bien aussi dans ce texte c’est qu’il apporte une « lumière totalement différente » sur les oppositions souvent marquées par des ruptures, des échanges ponctués de colères, ou au contraire (ou en même temps) par une indifférence un peu dédaigneuse , un agacement vis-à-vis de leurs centres d’intérêts qui nous semblaient futiles, par une méconnaissance totale de leur savoir-faire…tous ces comportements qui nous semblent négatifs , pèsent lourd sur notre conscience et nous submergent de regrets…Non, nous rassure Tim Ingold (selon mon interprétation !) : « ces forces opposées » , ces « frictions », ces « oppositions », ces « tensions » ont au contraire permis (à notre insu) un enroulement solide autour de la vie de nos parents, de nos grands-parents pour que les vrais sentiments résistent au fil du temps et ne s’effilochent jamais…