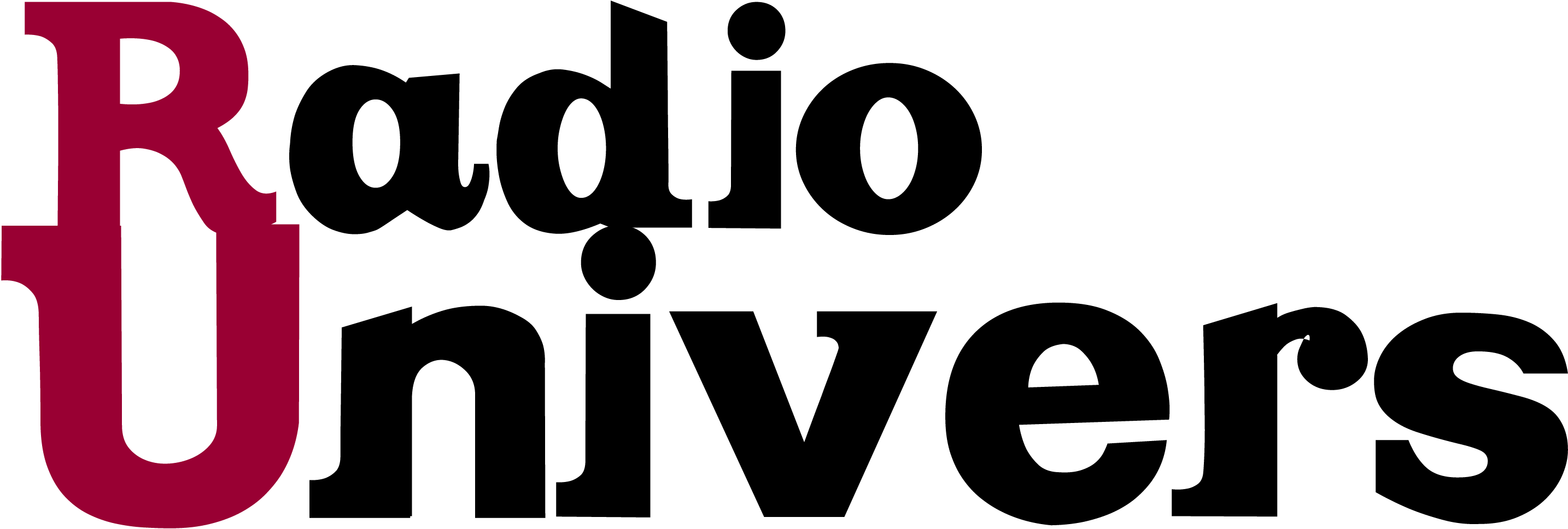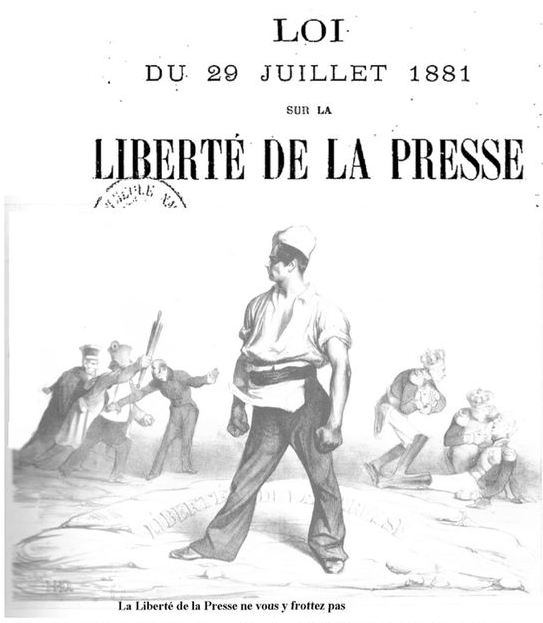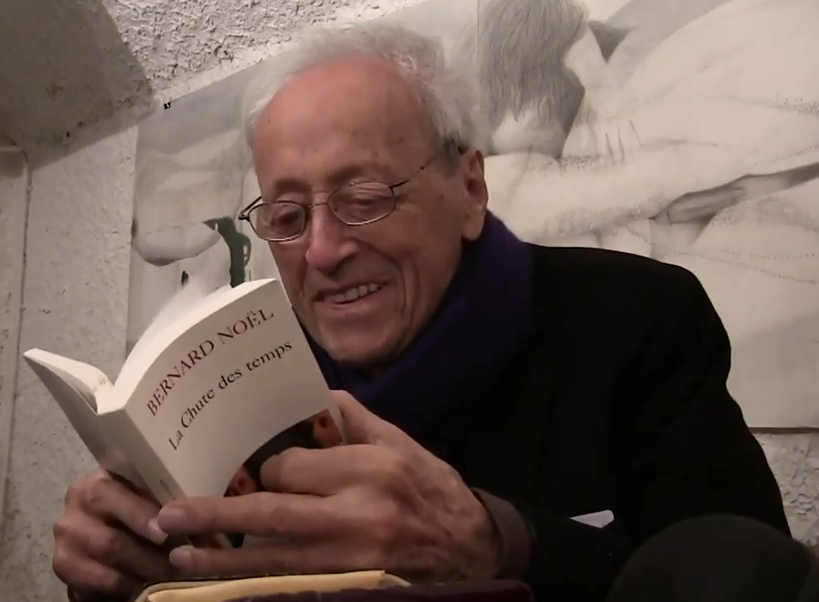« Toujours en veille ». N°967
Écrit par admin sur 18 novembre 2020
S’il s’interrogeait sur la nature du consommable, notre monde devrait faire disparaître l’avenir pour que n’existe plus que le présent. »
Bernard Noël, écrivain, poète. Lire ici.

Ci-gît l’avenir ? Question posée. En cette période rude et tellement morose. D’usage domestique avant, son élimination à petit feu du langage courant est telle que c’en est troublant. Jusqu’à devenir un terme archi-désuet, comme s’il n’avait plus lieu d’être là. Globalement accueillant autrefois, l’on bute dessus de nos jours. Quelle en est la cause? Le soupçon porterait-il sur le fait qu’il soit dénué de toute probabilité, de toute totalité susceptible d’être mesurée, régulée, qu’on pourrait faire croître ?
Soyons vifs, ouvrons les oreilles ! Avenir ? Pfff ! Concept incalculable, pas évaluable, pas mesurable, donc démodé ! Bernard Noël a raison, tout le langage qui a cours est là pour accroître l’impression de perte générale d’un à-venir rêvé.
Or « C’est du rêve que vient toujours la possibilité de créer du nouveau », rappelait le regretté philosophe Bernard Stiegler, à lire ici. Pointant là ce qui est « en passe d’être détruit par le calcul ».
Perçu sans… avenir, l’avenir ? Question saugrenue, direz-vous, à l’heure de la précarité de la vie sous toutes ses formes : précarité vitale de l’exposition au virus qui semble décidément ne pas devoir connaître de fin. Mais aussi précarité sociale. Les chiffres donnent le vertige. Est-ce à dire, pour autant, qu’on peut vivre une pandémie sans que l’on se réinvente nos vies ? Non. Protéger – avec le décompte quotidien des morts – n’est pas inventer. Reprendre la piste de notre capacité indéfinie d’invention, c’est reparler d’avenir – pour ne pas être «algorithmisé».
Mais si sévit pareille jacasserie autour des inquiétudes, des incertitudes et des défiances quant à l’avenir, ne serait-ce pas justement à la faveur de son appauvrissement dû à l’intrusion virale du « consommable » avec des conséquences dévastatrices pour le langage social ?
De l’avenir et du langage social, comme « besoins essentiels » de la jeunesse, c’est de cela dont il est question dans le long entretien qui suit, accordé à la radio milanaise Radio Popolare par l’un des intellectuels qui n’hésitent pas aujourd’hui à penser à l’échelle du monde.
Anthropologue américain d’origine indienne qui vit à Berlin, enseignant « la communication et la culture des médias » à l’université de New York, Arjun Appadurai est reconnu comme l’un des représentants principaux de l’anthropologie culturelle.
D.D

« RP: Professeur Appadurai, six mois se sont écoulés depuis le début de la pandémie. Le Covid-19 a-t-il bloqué ou ralenti la mondialisation ?
Comme, pendant le Covid, les voyages, les aéroports, les communications et surtout les mouvements touristiques ont été fortement limités, on pense que le bouton pause sur la mondialisation a été enfoncé et que, dans le même temps, on assiste à une sorte de retour ou de renaissance de l’État-nation. Je pense que cette analyse n’est pas exacte, car la mondialisation continue de faire partie de notre monde à bien des égards.
Je veux dire que la mondialisation, comme la révolution industrielle, comme le capitalisme, est quelque chose d’irréversible. Nous pouvons les défier, mais nous ne pouvons pas revenir en arrière et entrer dans un monde avant la mondialisation.
Je vois des preuves, des preuves, pour lesquelles presque tous les Etats-nations continuent à pratiquer leurs négociations sur le commerce mondial, sur le commerce des armes qui est très actif (notamment en France, aux Etats-Unis, en Arabie Saoudite, en Inde, en Chine), un vrai big business. Un autre exemple est la finance mondiale qui contrôle une grande partie de nos vies et qui n’a pas du tout ralenti.
En effet, la finance n’est pas basée sur des relations de face à face, mais uniquement sur des opérations numériques. Je pourrais donner d’autres exemples comme ceux-ci, mais je veux juste dire que cela me convainc que la mondialisation se poursuit vraiment à un rythme considérable.
En même temps, il y a quelques ajustements dans la façon dont l’État-nation traite la mondialisation. Même les États-nations qui subissent de fortes pressions pour fermer leurs frontières, pour donner la priorité à la santé de leurs citoyens, tous ces États dépendent de la collaboration et de l’assistance technique, scientifique et médicale transfrontalière. Même au cœur de la campagne pour vaincre le Covid se trouvent des processus de coopération et de collaboration internationales et mondiales. Je ne pense donc pas que la mondialisation sera transformée ou ralentie ou bloquée par le Covid-19.
RP: Professeur Appadurai, en écoutant votre liste, il semble que la « mauvaise partie de la mondialisation » (je la mets entre guillemets) soit particulièrement vivante. Je parle de la finance, du commerce des armes. Il semble que ce soit le cas.
Certaines de ces choses ne sont évidemment pas bonnes, je veux parler du commerce des armes, du commerce mondial de la drogue ou de la traite des êtres humains, ou encore de la cyber-surveillance transfrontalière. Ce sont de très, très mauvaises choses.
Mais les bonnes choses ne se sont pas arrêtées là. Par exemple, le partage d’informations entre pays, villes, sociétés sur la manière de faire face à l’urgence du Covid ; ou le partage de connaissances techniques sur les données relatives à la maladie, ou la collaboration scientifique sur les vaccins, sur les traitements. Ce sont des choses que j’appellerais « la bonne partie de la mondialisation ».
La mondialisation a toujours des « parties sombres », mais en même temps elle a aussi des parties positives, car elle fournit un cadre dans lequel non seulement la coopération et le commerce, mais aussi le cosmopolitisme, l’expansion de l’imagination, tout cela pour fournir un contrepoint à la xénophobie, au localisme.
Dans ce contexte, la mondialisation a deux faces. Et à tout moment, une partie, un visage, semble avoir plus d’attention de notre part. Aujourd’hui, avec le Covid, nous sommes tous très préoccupés par les voyages, par les migrants, par les étrangers. Mais en même temps, nous voulons que nos marchandises soient livrées par Amazon, nous voulons rester en contact avec nos amis grâce aux médias sociaux… Ce sont des choses mondiales… Toute la race humaine veut le meilleur et demande que les autres s’occupent du pire. Mais c’est une utopie.
RP: Je reviendrai plus tard sur le sujet de la mondialisation. Professeur Appadurai, quel genre de société sont celles de l’ère Covid-19 ? À quel genre de transformations sociales assistons-nous ?
Encore. Vous pouvez voir le verre à moitié plein ou à moitié vide. La partie à moitié vide est ce que nous savons : le Covid a produit une énorme quantité d’anxiété, de peur, d’incertitude. Il a également engendré beaucoup de déception, tant vis-à-vis de l’État que de la science, pour ne pas avoir trouvé de solution, une solution magique.
De plus, le Covid a aliéné chacun d’entre nous de nos habitudes sociales quotidiennes : nous ne pouvons pas voir les gens face à face, nous ne pouvons pas les serrer dans nos bras, les embrasser, manger confortablement avec eux. C’est une situation qui s’améliore légèrement à certains endroits, mais pas à d’autres.
Le coût le plus important est que notre principal moyen de communiquer les uns avec les autres a été suspendu. Pour ceux d’entre nous qui disposent de la technologie numérique, ils peuvent compenser ce manque. Mais pour 60 à 70 % de la population mondiale, la technologie numérique n’est pas disponible, alors ils sont rejetés dans leurs familles, dans leurs maisons, dans leurs quartiers. Il s’agit de coûts sociaux très élevés.
C’est ce qui se passe d’une part.
Mais d’un autre côté, si vous regardez l’Allemagne, mais aussi l’Italie, la Lombardie, la Corée ou bien d’autres endroits, vous pouvez constater que l’État ne peut pas tout faire sans que les gens ordinaires s’activent, participent à l’effort, par exemple en portant des masques, en gardant des distances sociales, en se lavant les mains, en évitant les contacts inutiles avec des inconnus. Sans tout cela, tout l’effort pour combattre le Covid aurait échoué de façon désastreuse, pire que ce qu’il a fait jusqu’à présent.
Et cela signifie, et c’est la meilleure nouvelle du point de vue de la société, que la société compte à l’échelle mondiale, que nous ne sommes pas seulement des créatures des États ou des marchés ou des élites de grandes entreprises, ou des entrepreneurs dans le secteur de la haute technologie, mais que notre capacité quotidienne de citoyens ordinaires compte, que ce soit à Bombay ou à Milan ou au Maroc. Les gens comptent, la société compte. Nous ne vivons pas dans un monde composé uniquement d’États, d’entreprises et de marchés. C’est une très bonne nouvelle pour moi !
Les gens comptent, la société compte. Nous ne vivons pas dans un monde composé uniquement d’États, d’entreprises et de marchés. C’est une très bonne nouvelle pour moi ! »
RP: Professeur Appadurai, dans l’un de vos derniers livres « Betting on words », vous affirmez que le crack économique de 2008 a été un échec (gardez ce mot à l’esprit, chers auditeurs) du langage. Dans quel sens ?
Dans le livre « Parler sur les mots », je soutiens certains arguments hétérodoxes disant qu’il y a bien sûr d’autres facteurs (réglementations faibles, investisseurs trop spéculatifs, prise en charge inadéquat de la sécurité et des préoccupations des investisseurs ordinaires), il y a de nombreux facteurs mais je soutiens qu’un facteur – dont j’ai été fasciné – est la langue.
Pour moi, la langue est importante parce qu’elle est le principal outil par lequel fonctionnent les marchés financiers mondiaux, par exemple les produits dérivés.
Les produits dérivés sont des contrats entre des négociants qui travaillent pour des banques ou des fonds spéculatifs. Il s’agit de contrats basés sur la valeur potentielle de quelque chose dans le futur.
Imaginez quelque chose qui existe aujourd’hui et qui a une valeur future : vous et moi concluons un accord parce que nous avons des idées différentes sur ce que sera cette valeur dans le futur. C’est un pari. Mais quand on trouve l’accord, c’est un contrat.
Il s’agit simplement d’un accord selon lequel si « A » se produit, je vous paierai, si « B » se produit, vous me paierez.
Il s’agit d’un contrat écrit, mais il était auparavant oral.
Et c’est ainsi que fonctionne cet énorme marché de plusieurs milliards de dollars, par le biais de quelqu’un qui dit à quelqu’un d’autre : « Eh bien, le marché est conclu ! »
C’est un acte de parole, c’est une promesse, il n’y a rien à échanger à la main, sauf ce sur quoi vous pariez.
RP: Excusez-moi professeur Appadurai, cela signifie-t-il que l’effondrement financier de 2008 a été l’effondrement de cette langue dont vous parlez ?
Oui, c’est l’effondrement de ces instruments qui avaient des bases linguistiques, rendues possibles par des promesses construites sur de très petites bases de biens réels, par exemple des maisons.
Les produits dérivés permettent à une maison normale de devenir la base d’une série infinie de transactions sur l’avenir (sous forme de contrats, de promesses et d’autres formes linguistiques). Mais les maisons étaient limitées, elles ne pouvaient pas supporter le poids de cette montagne de promesses, car la valeur des maisons ne s’élève pas à l’infini.
Tout le monde le savait, mais ils pensaient que le crack se produirait après avoir encaissé les bénéfices.
Un jour, la musique s’est arrêtée. C’était en 2008. La montagne de la promesse a volé en éclats. Le gouvernement américain a dû intervenir en utilisant l’argent public pour combler le vide et rétablir le marché financier.
Ils ont fait valoir que sans le marché financier, l’ensemble du système capitaliste échouerait et que s’il échouait, la planète entière s’effondrerait.
Il est évident que ce sont des idées exagérées, mais il faut dire que ce sont elles qui ont permis de sauver le système dans lequel la langue prend la forme de contrats, de promesses (écrites et orales).
Tout cela n’est pas secondaire, mais c’est la principale caractéristique de la prise de risques d’un avenir inconnu et de les monétiser.
C’est là que se situe l’échec du langage.
L’échec de la finance peut être considéré comme un échec du langage.

RP: J’aimerais rester sur le sujet de la langue, professeur Appadurai. Au sujet de ce Covid-19, j’aimerais savoir si vous le considérez comme un échec du langage social au profit du langage de la science biologique. Ces derniers mois, nous avons surtout écouté les virologistes, les épidémiologistes, les experts pharmaceutiques et nous avons moins écouté les architectes, les urbanistes, les designers, etc. Y a-t-il eu un échec d’un langage social par rapport à un langage bioscientifique ?
Exact. Je dirais que je suis d’accord avec vous. C’est une observation très intéressante.
Je dirais que beaucoup des plus importants penseurs européens, comme Giorgio Agàmben, n’ont pas été capables de transformer leurs idées en une sorte de nouvelle réflexion sur la manière de traiter le Covid, sur ce que cela signifie, sur ce qui va nous arriver.
Ils regardent encore le monde avec les yeux des décennies passées, des générations précédentes, des modes de pensée précédents.
Qu’il s’agisse d’Agàmben ou Zizek, ou d’autres grands penseurs européens, ou des penseurs américains comme Judith Butler et d’autres, ils ont tous été incapables de fournir le « langage social » dont vous parlez et qui servirait à nous faire avancer.
Donc, vous avez tout à fait raison.
En conséquence, nous avons connu une remarquable explosion de déclarations scientifiques, de débats scientifiques et d’informations scientifiques qui ont été déversés sur les gens ordinaires avec beaucoup de poids, de rapidité et d’autorité.
J’ai écrit ailleurs sur une métrique particulière, des chiffres, des graphiques d’une énorme complexité qui nous ont toujours fascinés, que nous n’avons jamais pu comprendre et qui ne nous ont jamais mis d’accord.
Il y a donc cette quantité écrasante de chiffres scientifiquement fondés que nous ne sommes pas équipés pour comprendre.
Devant nous, il y a un problème d’alphabétisation.
Ainsi, d’une part, je suis d’accord pour dire que la science contemporaine a été la principale ressource pour combattre directement le virus en tant qu’objet physique.

Toutefois, cela ne signifie pas que nous comprenons tout ce qu’on nous dit, car nous ne sommes pas assez instruits pour comprendre des chiffres aussi complexes. Presque personne ne l’est.
Nous sommes encore moins équipés pour comprendre lorsqu’il y a des débats entre deux scientifiques. Comment puis-je porter un jugement lorsque les deux scientifiques disposent de graphiques et de données d’une telle complexité ?
C’est un gros problème, l’alphabétisation, numérique et scientifique. L’alphabétisation sur les probabilités, les projections, les chiffres. La plupart des gens ne l’ont pas.
D’autre part, il y a ce que vous avez indiqué, qu’il y avait une sorte de « vide » du côté de ce que vous avez appelé le « langage social » et que j’appellerais autrement.
Dans un de mes vieux livres (« L’avenir comme fait culturel »), j’ai proposé un contraste entre « l’éthique de la probabilité » et « l’éthique de la possibilité ».
La probabilité est le mot dans lequel nous vivons : nombres, risques, incertitude, probabilité, projections… vous pouvez utiliser des milliers de mots, mais ils sont tous du côté de l’éthique de la probabilité.
D’autre part, nous avons besoin de quelque chose de fort, du côté de l’éthique du possible, qui est l’éthique de l’espoir, de l’aspiration, du désir, de l’imagination, de l’inspiration.
Je suis tout à fait d’accord avec vous pour dire que nous avons un échec relatif de ce côté, c’est-à-dire du côté du langage social ou du langage des possibilités qui a été écrasé par le discours des probabilités, je pense au langage de la médecine et des sciences connexes.
Nous avons besoin de ces sciences, mais nous avons besoin d’un dialogue entre ce langage et ce que vous appelez le langage social.
Sinon, tout l’effort devient unilatéral et nous devenons une sorte de consommateurs passifs de données numériques que nous ne comprenons pas ; nous devons donner notre vie à quelqu’un qui nous dit quoi faire : porter un masque ou non ; rester à six mètres et non à cinq. Nous devons accepter ces situations et ce n’est pas très bon pour une vie démocratique saine.
Je suis donc d’accord avec vous : il y a un échec du côté du langage social.

RP: L’idée de l’avenir qui se dégage de vos études est une idée de l’avenir toujours corrélée à un risque. « Un avenir sur lequel nous pouvons parier », avez-vous dit plus tôt. Un mécanisme des marchés financiers. L’avenir est-il seulement ce risque sur lequel nous pouvons parier ou est-ce aussi autre chose ?
C’est important pour moi que ce soit aussi autre chose. J’avais l’habitude de dire que transformer l’avenir en un risque, et rendre ce risque monétisable, pour faire en sorte que 1% des gens qui reçoivent des milliers de fois plus d’argent que le reste des autres, c’est la situation où l’avenir devient juste quelque chose lié au risque.
En même temps, et de manière similaire au cas de Covid, l’avenir devient une simple projection numérique. Ce n’est pas bon pour moi. C’est ce que le grand Ulrich Beck a prédit lorsqu’il a déclaré que nous entrions dans une « société du risque » mondiale, où tout est un risque, où les choses qui peuvent arriver peuvent être prévues et gérées.
Bien sûr, Beck n’avait pas beaucoup parlé de finance, mais si nous examinions la finance aujourd’hui, nous verrions que cela (le risque) fait également partie de la finance.
Dans mon livre « Miser sur les mots », mais aussi dans mon précédent livre sur l’avenir (« Le futur comme fait culturel »), j’ai toujours indiqué une critique potentielle de ce type d’abandon complet du futur en faveur d’un scénario de risque, d’une stratégie de risque.
La vérité est que – même en ce qui concerne le risque – nous avons oublié l’autre partie, qui est l’incertitude.
Les gens vivent beaucoup d’incertitudes. Nous ne devrions pas avoir honte de dire « je suis incertain de quelque chose ». Mais dès que nous commençons à poser la question en termes probabilistes, cela signifie que nous avons déjà commencé à jouer le jeu du risque.
Je suis partisan de la recherche de nouvelles langues pour l’avenir, pour parler de l’avenir, pour imaginer l’avenir, pour discuter de l’avenir.
Je dirais très simplement, et en termes un peu démodés, que nous devons considérer la qualité autant que la quantité.
Par conséquent, nous devons donc équilibrer les chiffres avec d’autres dimensions de ce qui est souhaitable dans notre avenir possible.
Dans le passé, il y avait une arène et un discours qui faisaient ce que je disais, mais pour beaucoup d’entre nous aujourd’hui, qui sont des universitaires, ou des journalistes comme vous, ou des universitaires ou des critiques, des politiciens… tout cela est devenu insuffisant. C’est la question de la religion.
Dans le passé, la religion parlait de la qualité de l’avenir : rédemption, survie, salut.
Mais depuis que nous avons perdu ce vocabulaire, la plupart d’entre nous ont maintenant besoin d’autres vocabulaires qui peuvent nous aider – en tant que citoyens sensibles à l’égalité, la justice, la liberté et l’inclusion – à trouver des moyens de parler de la qualité de notre vie sociale, de nos mots sociaux, de notre pays et de notre monde, y compris la planète.
Mais si nous nous en remettons toujours aux chiffres (combien les glaciers fondent, combien le niveau des rivières monte), il y a une limite à ce que nous pouvons faire.
Cela ne devrait pas s’agir d’un dialogue sur l’utopie, les villes parfaites, les transports parfaits, mais sur quelque chose qui nous entoure, mais qui n’est pas encore totalement disponible.
L’expression « pas encore », pas encore, c’est ce que je tire du philosophe Ernest Bloch, des grandes études sur les principes de l’espoir.
Bloch utilise cette expression « pas encore », qui signifie : quelque chose qui est là, mais pas encore complètement développé.
C’est de cela dont nous avons besoin, et non d’une utopie parfaite, parce que c’est d’abord impossible et ensuite parce que cela devient rapidement une idée fasciste : vous nous donnez tout, vous nous donnez votre liberté, et nous vous donnerons la perfection ! Cela a toujours été une fausse promesse.
C’est donc ce que j’entends par qualité et ce que vous définissiez en termes de « partie sociale » par opposition à une « partie scientifique » du langage.
Tout cela est cohérent et lié à mes souhaits et mes espoirs. Nous trouverons des langues dans lesquelles les experts et les gens ordinaires pourront converser non pas tant par le biais de discours de haut niveau sur les chiffres, les graphiques, les statistiques ou la finance, mais par le biais d’aspects qualitatifs de questions telles que le sens de la vie, ce que signifie être heureux, ce que signifie être en bonne santé.
J’ai utilisé le terme « santé sociale » par opposition au terme « santé médicale ».
La « santé médicale » est importante.
Mais la « santé sociale » exige un autre type d’attention aux relations, à la solidarité, aux réseaux, qui ne relève pas sous la rubrique des probabilités, des chiffres et des statistiques.
RP: L’échec est le titre de son dernier livre. Lorsqu’elle parle d’échec, elle fait référence à deux mondes, Wall Street et la Silicon Valley, qui « favorisent tous deux l’illusion que la pénurie peut et doit être éliminée à l’ère de la fluidité ». Quel est l’échec que vous analysez, professeur Appadurai ?
Comme vous le savez, j’ai écrit ce livre avec ma co-auteure et merveilleuse universitaire Neta Alexander, qui s’intéresse au monde numérique émergeant de la Silicon Valley.
En étudiant davantage le monde de la finance, nous avons mis en commun nos connaissances et sommes arrivés à la conclusion suivante : l’un des courants les plus profonds de ces deux régimes, ou de ces deux forces provenant de la Silicon Valley et de Wall Street, est que ces deux régimes nient toute forme de limite à ce que nous pouvons acheter, à ce que nous pouvons apprécier, à notre richesse…. tout est possible !
Ensuite, il arrive que nous entrions sur les marchés financiers ou dans le monde de Netflix, de Twitter ou des rencontres numériques, et nous devenions constamment exploités et appauvris ou déçus.
En d’autres termes, les bonnes choses n’arrivent pas après toutes les promesses que tout est possible, mais l’échec nous est transmis. Ce truc a échoué parce que vous n’avez pas fait cela, parce que vous n’aviez pas assez de bande passante pour vous connecter, parce que vous n’avez pas nettoyé votre ordinateur, parce que vous n’avez pas appris cette langue. On ne dit jamais que la banque ou Netflix sont responsables.
Et puis on nous considère comme les pics qu’ils essaient de réparer. Mais le processus de réparation ne s’arrête jamais. En attendant, tous les échecs sont attribués aux clients, aux consommateurs, aux citoyens.
Et toutes les grandes promesses sont tenues pour les personnes qui contrôlent les technologies de pointe, les banques, les entreprises numériques.
Ils sont considérés comme de hauts prélats sans tache et nous comme de pauvres pécheurs voués à l’échec.
Nous sommes la cause de tous les échecs, et ils nous apportent toutes les promesses de succès.
C’est ce que nous voulions capturer dans le livre. J’espère que vous avez reçu certains éléments de ce que j’ai à l’esprit. »

Ce qui a été dit et écrit ici-même autour de Radio Popolare.